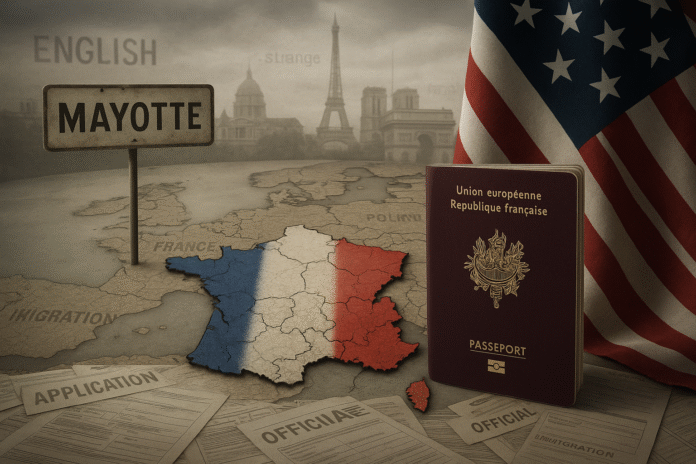Face à la multiplication des crises migratoires, à l’affaiblissement manifeste de l’Union européenne, à la riposte sécuritaire de la France à Mayotte et à l’offensive culturelle américaine, la souveraineté nationale – tant juridique que culturelle – vacille dangereusement. Comment et pourquoi la France et l’Europe en sont-elles arrivées à douter de leur propre capacité à défendre leurs frontières, leurs lois et leur identité face à la mondialisation débridée ?
En 2025, alors que l’Union européenne vacille sous le poids de son élargissement mal maîtrisé et des fractures internes sur la question migratoire, la France affronte à Mayotte un afflux incontrôlé de clandestins auquel elle ne sait plus répondre que par des lois d’exception validées in extremis par le Conseil constitutionnel. Dans le même temps, les États-Unis, sous la férule de Donald Trump revenu au pouvoir, appliquent une politique migratoire redoutablement efficace : contrôle des visas, expulsions massives, suspension brutale des admissions de travailleurs et d’étudiants étrangers. Parallèlement, sur le front culturel, la France assiste, impuissante, à la déferlante de la langue anglaise – malgré la loi Toubon pourtant adoptée il y a trente ans pour protéger le français dans l’espace public, alors même que la cérémonie d’ouverture des JO de Paris en 2024 en a donné une illustration saisissante.
Partout, les digues nationales cèdent sous la pression conjuguée de la technocratie bruxelloise, du laxisme migratoire, et de la domination culturelle américaine. Qui pilote encore la destinée des peuples européens ? À Bruxelles, à Paris, ou à Washington ? Derrière ces bouleversements, une certitude : la souveraineté nationale, longtemps considérée comme indiscutable, se retrouve aujourd’hui marginalisée, attaquée sur tous les fronts – législatif, sécuritaire, identitaire, linguistique. Face à ce double choc, la question n’est plus seulement de s’adapter, mais de savoir s’il reste possible pour les nations européennes, et la France en tête, de défendre leurs frontières, leurs lois et leur identité.
La bataille qui s’ouvre n’est rien de moins que celle de notre survie collective.
2025 : l’Union européenne au bord de l’implosion
L’année 2025 en Europe restera celle où les contradictions latentes de l’Union européenne ont éclaté au grand jour. Selon Noëlle Lenoir, ex-ministre des Affaires européennes, l’élargissement qui devait « réunifier le continent » a « totalement transformé et malheureusement affaibli » l’UE, la rendant ingérable : « Le bateau s’est chargé et en se chargeant, il est devenu plus instable. » Cette instabilité ne relève plus du simple débat théorique. Avec aujourd’hui cinq millions de demandes d’asile en attente à l’échelle européenne (Eurostat, T2-2025), et une majorité d’États membres incapables de dépasser 20% d’exécution réelle des obligations d’expulsion (source ICMPD citée par l’AFP), la fracture est béante.
Bruxelles, sous pression d’opinions publiques excédées et de gouvernements confrontés à la poussée des nationaux-conservateurs, a bien tenté de réagir. Le Pacte européen sur la migration de 2024 vise à externaliser le problème, en finançant des “centres de retour” au Bangladesh ou au Pakistan pour migrants déboutés, et en collaborant avec des régimes à la réputation plus que discutable (Tunisie, Libye, Algérie demain ?). Michael Spindelegger, patron de l’ICMPD, affirme : « Le train est en marche. » Mais si 80% des décisions d’éloignement n’aboutissent pas, c’est moins un plan de fermeté qu’un aveu d’impuissance, dénoncé tant à droite qu’à la gauche radicale – preuve d’une perte de contrôle flagrante.
La riposte sécuritaire française : le cas Mayotte
Face à ce chaos globalisé et à l’impuissance de Bruxelles, la France tente localement de reprendre la main. Le Conseil constitutionnel a validé le 7 août 2025 presque toutes les dispositions phares du “plan Mayotte” : conditionnement du titre de séjour des parents d’enfants français à une entrée régulière, centralisation des reconnaissances de paternité pour lutter contre la fraude, élargissement des possibilités d’éloignement, et dérogation temporaire à l’obligation de relogement en cas d’évacuation de bidonvilles.
Les Sages se sont appuyés sur un constat objectif : à Mayotte, la population étrangère (en majorité illégale) atteint 48% et le ratio de naissances d’enfants d’au moins un parent étranger dépasse les 75%. Motif invoqué ? « Les caractéristiques et contraintes particulières au sens de l’article 73 de la Constitution. » Il aura fallu l’effondrement de l’ordre public et la pression de mouvements locaux pour que l’État français ose écorner le dogme de l’égalité, au nom de la survie du territoire national. Mais cette “mise sous cloche” d’un département français préfigure-t-elle un changement de paradigme pour l’Hexagone tout entier, ou n’est-elle qu’un signal d’alerte ?
Les États-Unis, modèle de fermeté migratoire
Outre-Atlantique, la logique est implacable. La nouvelle administration Trump, intraitable sur la question migratoire, a ordonné des vérifications continues sur les plus de 55 millions de visas délivrés – menace de révocation à la moindre suspicion d’irrespect de la loi, d’atteinte à l’ordre public, ou même d’« opinion antiaméricaine » sur les réseaux sociaux. En parallèle, la délivrance de visas à certaines professions (chauffeurs routiers, étudiants) est suspendue ou drastiquement réduite, quitte à provoquer la fureur des lobbies patronaux.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 6 000 visas étudiants révoqués depuis le début de l’année, et jusqu’à 700 000 conducteurs routiers étrangers désormais menacés de perdre l’accès au marché du travail américain. La logique affichée par le secrétaire d’État Marco Rubio : « Les avantages liés à l’immigration restent un privilège et non un droit. » Une leçon de souveraineté assumée – à mille lieues de l’impuissance normative bruxelloise.
Le choc culturel et la défaite de la langue française
Mais le choc migratoire ne va pas sans un choc identitaire et culturel. La loi Toubon de 1994, censée sauvegarder la “langue de la République”, fait figure aujourd’hui de relique dans un paysage saturé d’anglicismes, que ce soit dans la publicité, la culture, ou même la science. Vingt ans après la mise en garde de l’Académie française, le constat demeure sans appel. L’État ne protège plus efficacement le français, même dans la sphère publique – comme l’ont illustré les Jeux olympiques de Paris, où la “célébration” finale, via Aya Nakamura, a légèrement effleuré l’identité nationale sans lui rendre l’hommage exclusif qu’elle mérite.
Pour reprendre les mots de Jean d’Ormesson lors du débat sur la loi Toubon : « La langue française est notre bien commun, et nous voulons la défendre. » Trois décennies plus tard, qui porte encore ce flambeau ? L’omniprésence de l’anglais scelle la défaite culturelle d’une élite plus prompte à parler diversité qu’à défendre l’enracinement.
Conséquence : le mythe d’une souveraineté européenne “inclusive” n’a jamais paru aussi creux. Prise en étau entre la technostructure européenne, le cosmopolitisme ambiant et la “soft power” américaine, la France – comme nombre de nations européennes – risque la dissolution de ce qui assurait sa singularité.
Retraite historique et dérive du modèle européen
Pour comprendre la crise actuelle de la souveraineté – qu’elle soit territoriale, législative ou culturelle –, il faut la replacer dans une trajectoire historique qui commence bien avant les secousses migratoires et identitaires des années 2020. Ce n’est pas un accident : c’est le fruit d’une succession de renoncements, de dérives politiques et d’ingérences extérieures, facilitées par le développement d’un modèle globalisé qui a sapé, pièce après pièce, la capacité des nations à se gouverner elles-mêmes.
Depuis Maastricht (1992), chaque étape de la construction européenne a été présentée comme une avancée vers la prospérité et la paix. L’élargissement massif de l’UE à l’Est (2004-2013) a radicalement transformé la physionomie du continent. Noëlle Lenoir le reconnaît elle-même : l’unification, censée solidifier l’Europe, a surtout généré des fractures Nord-Sud, Est-Ouest, sans réussir à harmoniser ni valeurs ni aspirations. Résultat : une machine institutionnelle obèse (un commissaire pour Malte comme pour l’Allemagne !), des politiques migratoires hors-sol, et un Conseil européen incapable d’offrir une vision commune, encore moins une protection claire des peuples. La “fin de l’histoire” de Fukuyama, espérée après la chute du Mur, a accouché d’une Europe divisée, plus sujette au chaos qu’à la stabilité.
Mayotte, laboratoire du délitement républicain
La crise migratoire n’est pas nouvelle, mais elle s’accélère. Déjà, au tournant des années 2000, l’explosion des demandes d’asile et des flux illégaux avait révélé la vulnérabilité des frontières françaises, aggravée par les accords de Schengen qui ont aboli tout véritable contrôle interne. Mayotte, aujourd’hui, n’est hélas que la vitrine d’un phénomène national : afflux massif, pression démographique, et sentiment d’impuissance chez les autochtones. Le Conseil constitutionnel, en validant des mesures d’exception, admet implicitement ce que le pouvoir central refuse de proclamer : il n’existe plus de solution généraliste dans la République une et indivisible – chaque territoire devient un laboratoire d’expédients pour tenter, en catastrophe, de colmater les brèches. Un symptôme de plus de la désagrégation de l’autorité nationale, incapable d’imposer ses lois de manière uniforme.
Les grandes puissances, la souveraineté sans états d’âme
Ailleurs, les grandes puissances ne s’embarrassent pas de tels états d’âme. Les États-Unis, sous Trump, réaffirment brutalement le primat des intérêts nationaux : contrôle en temps réel de 55 millions de visas, expulsions express à la moindre “suspicion”, suspension de filières professionnalisées entières (routiers, étudiants étrangers) et restriction généralisée sur toute forme de revendication “identitaire” non américaine. Rien ne leur interdit d’adapter leur droit au gré des urgences : là où l’Europe mégote, l’Amérique assume et impose.
Souveraineté culturelle : la tentation de l’abandon
Le phénomène n’est pas que démographique ou administratif : il est aussi culturel. La loi Toubon (1994), votée pour enrayer l’omniprésence de l’anglais dans la sphère publique, n’a fait qu’endiguer temporairement la déferlante. Trois décennies plus tard, entre Black Friday, communication institutionnelle anglicisée et nouveaux standards du show-business (l’affaire Aya Nakamura, la cérémonie des JO…), la France se retrouve à devoir “célébrer” sa culture en se pliant aux codes du marché global – même dans ses propres médias et institutions. La perte d’autorité politique s’accompagne de l’érosion du modèle culturel, la souveraineté linguistique s’évapore au profit d’un universalisme abstrait – et souvent anglo-saxon.
Un basculement du pouvoir hors des nations européennes
À l’heure où Bruxelles impose ses normes sans enrayer les flux, où Paris multiplie les exceptions dans ses propres territoires, et où Washington restructure son immigration au moindre fait divers, on observe un basculement du pouvoir réel hors des nations, et un affaiblissement systématique de tous les garde-fous historiques – frontière, loi, héritage linguistique. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : explosion des flux migratoires hors d’Europe, stagnation voire recul du taux de francophones dans le monde, et une part croissante de décisions nationales sous tutelle de juridictions ou d’agences extérieures (UE, ONU, Cours européennes, fonds internationaux…).
La question de la souveraineté n’est donc pas un vieux fantasme, mais la trame d’une réalité perçue par des millions de Français inquiets et lassés d’entendre que tout est fatalité – alors qu’ailleurs, on choisit, on tranche, on défend sa continuité nationale.
Quelques repères : chiffres et paradoxes
- Un élargissement européen qui creuse le fossé : en 2004, l’UE comptait 15 membres ; à l’arrivée des dix pays d’Europe centrale et orientale, puis de la Croatie, la population totale de l’Union a progressé d’environ 20 %. Une étude Eurobaromètre de 2024 confirmait déjà que plus de 60 % des citoyens de l’ »ancienne Europe » considéraient l’élargissement comme facteur d’instabilité politique et culturelle.
- Mayotte, chiffres d’un déséquilibre démographique inédit : la population officielle a plus que quadruplé en 40 ans, passant de 70 000 habitants en 1980 à plus de 310 000 aujourd’hui, pour une superficie équivalente à celle de la ville de Toulouse. Selon l’INSEE, près de la moitié des résidents ne possède pas la nationalité française. Près de 50 % des naissances à Mayotte sont issues de parents étrangers en situation irrégulière.
- Expulsions en berne : actuellement, moins de 20 % des décisions d’expulsion prononcées dans l’UE sont effectivement mises en œuvre (source : ICMPD/Commission européenne, 2025). Le système Schengen, s’il facilite la libre circulation, se révèle incapable d’assurer le renvoi effectif des clandestins, comme l’a reconnu Michael Spindelegger, directeur de l’ICMPD.
- Loi Toubon et efficacité réelle : la loi Toubon, adoptée en 1994, n’empêche toujours pas le recours massif aux anglicismes : 83 % des publicités télévisées utilisent au moins un mot anglais, selon une synthèse CSA 2023. Sur les réseaux sociaux, 40 % des influenceurs français publient régulièrement du contenu intégralement en anglais, y compris lors d’événements nationaux comme les JO de Paris 2024.
- Recul de la langue française à l’échelle internationale : le français, présenté autrefois comme la langue diplomatique, est désormais relégué au 5ᵉ rang mondial, derrière l’anglais, l’espagnol, le mandarin et l’hindi. À Bruxelles, moins de 3 % des documents officiels sont rédigés en français en version originale.
- France vs. États-Unis : contrôle des frontières. Aux États-Unis, plus de 6 000 visas étudiants révoqués en une seule opération administrative cet été, et suspension immédiate des visas pour chauffeurs routiers étrangers après un fait divers médiatisé. À l’inverse, en France, des recours et procédures contentieuses complexes rendent quasiment impossible l’expulsion de clandestins dans les délais annoncés.
- Centres de rétention et externalisation en hausse : l’UE finance désormais directement, via l’ICMPD, des camps de tri et de rétention en dehors de ses frontières (Bangladesh, Pakistan, Tunisie, Libye…), transférant de fait une partie de la politique migratoire à des pays tiers, malgré de lourdes suspicions de violation des droits de l’homme.
- Paradoxes de la “diversité festive” : les cérémonies officielles (JO de Paris 2024, par exemple) recourent à des artistes au style bourré d’anglicismes ou aux lyrics volontairement hybrides, quand d’autres nations (Japon, Corée, Russie) imposent le choix exclusif de la langue nationale dans leurs représentations internationales.
- Modèle Mayotte, impossible à généraliser ? Le Conseil constitutionnel, en validant des différences de traitement “territoriales”, acte de fait une rupture du principe d’égalité républicaine. Un précédent qui souligne à quel point l’État central ne sait plus comment adapter la loi commune à la réalité migratoire, préférant des exceptions locales à un modèle national assumé.
Perspectives
Le calendrier à suivre s’annonce décisif : prochaine réunion du Conseil européen sur le pacte migratoire prévue à l’automne ; discussions sur l’élargissement aux Balkans reportées sine die. En France, les nouvelles mesures à Mayotte seront appliquées dès le dernier trimestre 2025 ; les premiers bilans d’expulsions et de régularisation sont attendus début 2026. Quant aux États-Unis, l’extension des contrôles migratoires s’intensifie sous l’administration Trump ; les directives sur les visas et la surveillance permanente seront confirmées dans les textes fédéraux à l’automne.
La souveraineté ne se défend pas toute seule, elle s’entretient et se propage, jusque dans les détails du quotidien.